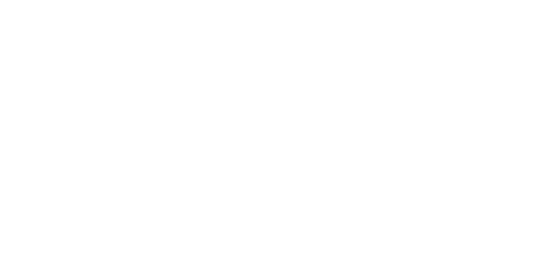L’actinote (Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2) appartient à la famille des silicates et au groupe des amphiboles : c’est l’amphibole verte. Le terme actinote, a été créé par René Just Haüy en 1801 à partir de aktis (rayon) et lithos (pierre) faisant allusion à l’aspect fibreux et radiés de ses cristaux. Les gisements d’actinote en France sont connus dans les Pyrénées ; ils sont liés aux roches métamorphiques.
Pierre dure, lourde, elle présente un clivage parfait selon le prisme vertical, avec deux angles de 120 ° et deux de 60 °. La forme prismatique et aciculaire (en pointe d’aiguille) de ses cristaux (jusqu’à 15 cm) permet de l’identifier. La couleur verte est liée à la présence de fer, son homologue magnésien, la trémolite étant de couleur blanche. Lorsque l’actinote se présente en inclusions très fines comme des filaments verts dans le quartz, on les appelle « cheveux de Thétis », la déesse de la mer dans la mythologie grecque.
L’actinote servait durant la préhistoire à la fabrication d’ustensiles et d’armes. La variété fibreuse de l’actinolite a permis de l’utiliser dans l’industrie de l’amiante. Aujourd’hui elle entre dans la constitution de matériaux résistant au feu, ainsi que dans les garnitures et patins de freins.