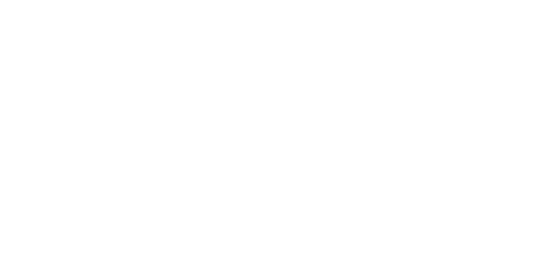Ce prisme est composé de trois faces en verre, rectangulaires, fixées sur des faces triangulaires. Il permet d’étudier la déviation et la décomposition d’une source lumineuse, et donc d’observer le spectre de décomposition d’une lumière blanche. On donna ce nom au prisme car c’est Newton qui a démontré que la lumière était composée de « bandes colorées ». Avant son expérience, on pensait que c’était le prisme qui contenait des couleurs, visibles seulement lorsque un faisceau le traversait. En plaçant un deuxième prisme sur le chemin de la lumière décomposée, il a observé un faisceau de lumière blanche en sortir. C’est donc la lumière qui a des « couleurs cachées », et non le prisme. Il n’est pas connu que pour avoir reçu une pomme sur la tête !
Ce prisme est composé de trois faces en verre, rectangulaires, fixées sur des faces triangulaires. Il permet d’étudier la déviation et la décomposition d’une source lumineuse, et donc d’observer le spectre de décomposition d’une lumière blanche. On donna ce nom au prisme car c’est Newton qui a démontré que la lumière était composée de « bandes colorées ». Avant son expérience, on pensait que c’était le prisme qui contenait des couleurs, visibles seulement lorsque un faisceau le traversait. En plaçant un deuxième prisme sur le chemin de la lumière décomposée, il a observé un faisceau de lumière blanche en sortir. C’est donc la lumière qui a des « couleurs cachées », et non le prisme. Il n’est pas connu que pour avoir reçu une pomme sur la tête !
 Ce polyprisme est fait de deux lames rectangulaires en verre, qui sont ajustées sur des cloisons triangulaires. Le prisme est divisé en plusieurs compartiments, pour accueillir différents liquides. Selon la nature du liquide, la lumière monochromatique en sortie du prisme à liquide aura un angle de réfraction différent. Le phénomène de dispersion appliqué avec une lumière polychromatique dépend de ce même paramètre. On place le polyprisme remplit de différents liquides transparents sur la trajectoire d’un faisceau de lumière monochromatique. On observe ensuite sur un écran les positions des rayons réfractés. Le rayon incident de la lumière est d’autant plus dévié sur l’écran, que l’indice de réfraction est grand. Lorsqu’on effectue cette expérience avec un faisceau de lumière blanche (lumière polychromatique), on observe différents spectres obtenus par réfraction. Plus le spectre est étendu, plus l’indice de réfraction est grand.
Ce polyprisme est fait de deux lames rectangulaires en verre, qui sont ajustées sur des cloisons triangulaires. Le prisme est divisé en plusieurs compartiments, pour accueillir différents liquides. Selon la nature du liquide, la lumière monochromatique en sortie du prisme à liquide aura un angle de réfraction différent. Le phénomène de dispersion appliqué avec une lumière polychromatique dépend de ce même paramètre. On place le polyprisme remplit de différents liquides transparents sur la trajectoire d’un faisceau de lumière monochromatique. On observe ensuite sur un écran les positions des rayons réfractés. Le rayon incident de la lumière est d’autant plus dévié sur l’écran, que l’indice de réfraction est grand. Lorsqu’on effectue cette expérience avec un faisceau de lumière blanche (lumière polychromatique), on observe différents spectres obtenus par réfraction. Plus le spectre est étendu, plus l’indice de réfraction est grand.