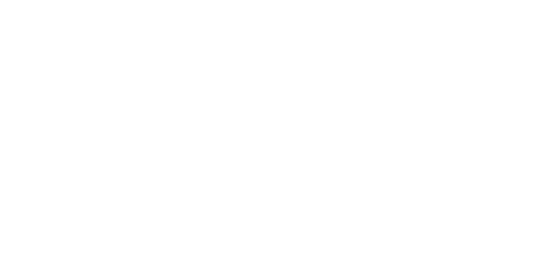L’astrolabe à prisme permet de déterminer les coordonnées géographiques d’un lieu (méthode de Gauss)en combinant l’instant de culmination qui donne l’une des coordonnées, et la hauteur de l’objet (déclinaison)qui donne l’autre. Il pèse 2 kg, c’est un instrument de campagne facilement transportable, et de plus assez précis (10 mètres environ).
L’astrolabe à prisme permet de déterminer les coordonnées géographiques d’un lieu (méthode de Gauss)en combinant l’instant de culmination qui donne l’une des coordonnées, et la hauteur de l’objet (déclinaison)qui donne l’autre. Il pèse 2 kg, c’est un instrument de campagne facilement transportable, et de plus assez précis (10 mètres environ).
Auguste Claude a décrit son fonctionnement en 1900 : « A l’une des faces du prisme équilatéral, j’ai adapté une lunette dont l’axe est perpendiculaire à cette face. La lunette et les arêtes du prisme sont toujours horizontales. La lunette et le prisme pivotent autour d’un axe vertical ; ainsi on peut observer dans tous les azimuts des hauteurs de 60° en se servant d’un horizon artificiel […]. L’observation consiste à noter l’instant où l’une des images, directe par exemple, vient coïncider avec l’image réfléchie ».
Ludovic Driencourt s’y intéresse, Vion va le construire, « l’astrolabe de Claude et Driencourt » est utilisé à partir de 1902.
Les astronomes de Toulouse s’en sont servis pour déterminer les coordonnées du Pic du Midi.